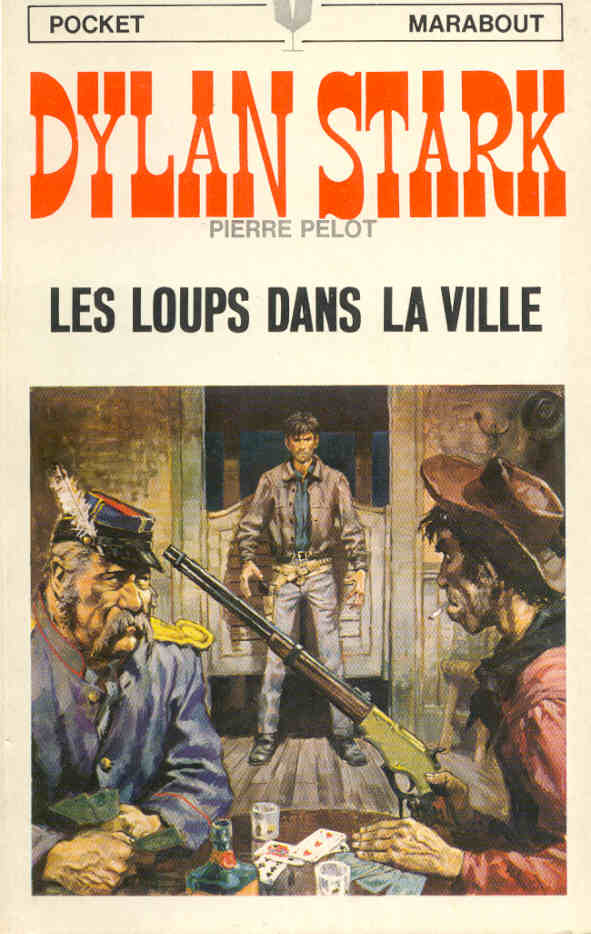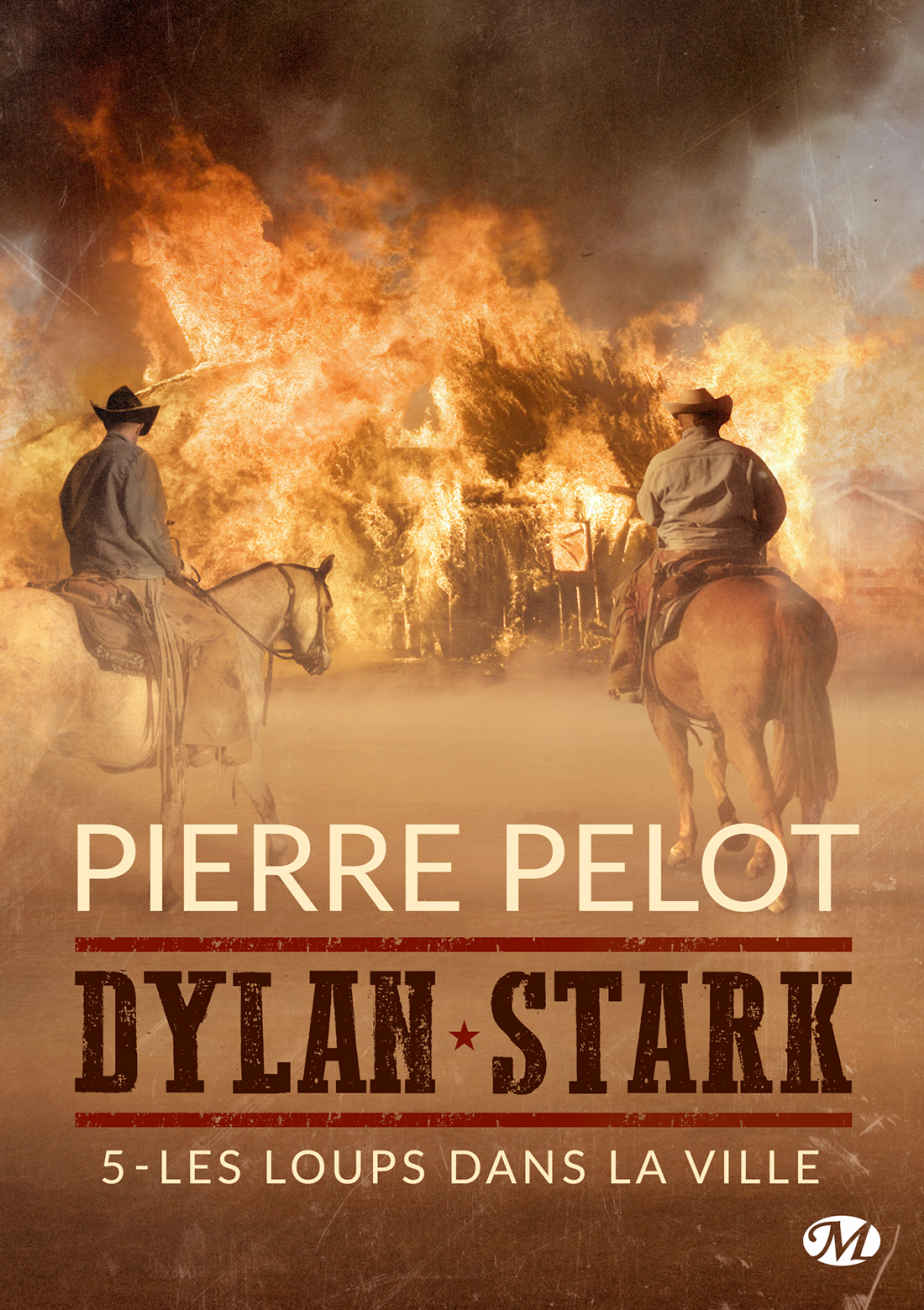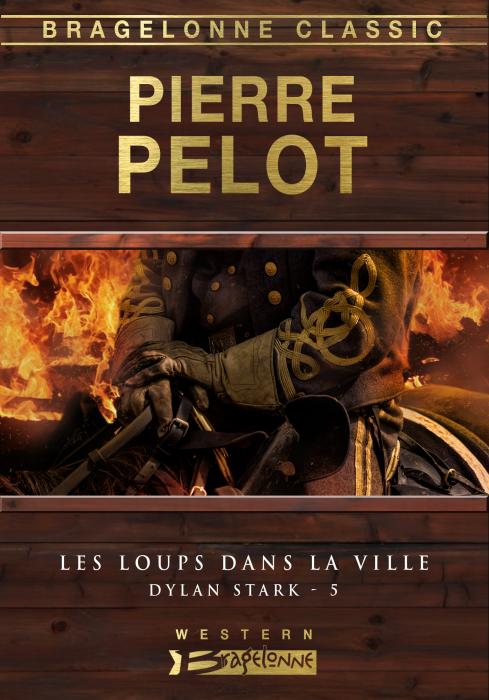Les Loups dans la ville
- Pierre Pelot
- 1967 | 11ème roman publié
- Western | Dylan Stark, 5
Date et lieu
Fin septembre - début octobre 1865, Arkansas.
Sujet
L'agglomération aux maisons brûlées est aux mains des fédéraux dirigés par Jeroham, un capitaine cruel et stupide. Le docteur ivrogne Fyn avoue qu'il ne peut rien pour Caerog bientôt victime de la cruauté du gradé qui le tue avant de jouer et de perdre sa dernière carte.
De ce temps où dominaient les loups dans la ville, il ne reste au héros que le souvenir des sanglots d'une fille dans la rue, - celle dont la vision a été assez forte pour qu'il chasse les intrus, - et l'image de quatre mottes de terre sur une tombe. (Raymond Perrin, Dylan Stark 2, Lefrancq, 1998).
Éditions
- Ne bougez pas. Ce n'est pas bon pour vous...
Un matin, on ne les avait pas vus, au Socko Saloon, Q.G. des "troupes d'occupation" commandées par le capitaine Jeroham. Ils avaient pressenti avant tout le monde que le capitaine Jeroham prenait un peu trop au sérieux son rôle d'occupant...
Le malaise de Sen était monté après cette triple désertion.
Quatre hommes pour l'enfer
Le Vent de la colère
La Couleur de Dieu
La Horde aux abois
Les Loups dans la ville
Les Loups sur la piste
Les Irréductibles
Les aventures du métis sudiste cherokee-français vont se succéder sur quelques années suivant la Guerre de Sécession, dans une vingtaine de titres, publiés aux éditions Marabout ou ailleurs, ainsi qu'en feuilleton ou nouvelles dans le journal Tintin.
Les sept titres qui composent ce volume suivent la chronologie de ces aventures. Le Vent de la colère fut initialement publié en marge de la série, et Dylan Stark s'y cachait sous un autre nom.
Première page
Il en avait assez.
Sen Benton en avait assez.
La nuit de cette fin septembre était claire, sans lune et fraîche. Toute pâle. Le ciel tranquillement appuyé aux montagnes était gorgé d'étoiles. Dans l'ombre verte et les éclats glacés collés aux choses de la terre, les bosquets piqués au hasard de la vallée, tout alentour de la ville, n'avaient pas de couleur définie. Septembre était venu et il avait tué les feuillages ; dans la nuit, les bosquets ne ressemblaient rien : des taches, des touffes brunâtres qui frissonnaient sous un souffle égaré de vent, des riens à peine consistants. On pouvait entendre les premiers pas du gel, hésitants, dans les feuilles tombées au sol, le gel comme une marée invisible et lente coulée dans les roseaux de la Hill-River, dans ses halliers. Et puis la grande vallée, coincée à jamais entre les dos ronds de la montagne, enfermée dans les griffes des tertres pelés, la grande vallée nue qui frayait un chemin pour la piste de Pineville, vers l'ouest, entre les pins, s'appliquant à bien s'étirer sur les terres vertes ou rougeâtres, ressemblait à une plage déserte, après la dernière vague, quand les algues demeurent.
Sen Benton connaissait la vallée, la ville, la montagne. Il connaissait la Hill-River crachée par la forêt du nord de la ville et se dépêchant dans l'ombre de la montagne, vers l'ouest comme la grande piste, vite, très vite, avant de tourner casaque devant les collines et filer plein sud, toujours aussi vite. Il connaissait le soleil du matin, à peine, soleil en septembre, qui effleurait du bout de la langue les tertres des gradins, la rocaille pâle et sèche de Bare Mountain, cet énorme amas de roches qui bouchait tout le ciel, au sud. Il connaissait.
Il n'aimait pas. Ce n'était pas son pays. S'il n'aimait pas, la terre n'y était pour rien. Il existe des hommes qui préfèrent la montagne, la roche et l'épine aux étendues planes des prairies ou aux végétations touffues et oppressantes du Sud. Il en existe. Il en est qui marquent une prédilection nette et affirmée pour les caillasses et les chardons, le soleil par là-dessus, pour la magie des forets éparpillées comme des flaques après une averse. Or, Sen n'aimait pas cela. Mais, encore une fois, la terre n'était pas en cause.
En vérité, Sen Benton n'avait aucun souvenir agréable perdu dans les rocs de Bare Mountain, dans les bosquets de la vallée, dans les vagues de la Hill-River et les ombres de la forêt. Voilà. Son pays à lui, c'était plus au nord, en Missouri… et c'était un pays brûlé. C'était l'image des cavaliers, la nuit - une nuit semblable à celle-ci, justement ! -, poussant les hommes et les femmes dans des chariots, jetant la torche dans les maisons, c'étaient les yeux de la mère et de l'oncle, fixes, les lèvres closes, les lèvres comme des montagnes de roche, et l'éclat d'incendie sur le visage… puis les cris des cavaliers, le claquement des rênes sur la croupe du vieux Rub, et la charrette qui s'ébranle : et toujours, à jamais, la mâchoire dure et serrée de l'oncle Finney. C'était cela, dans le comté de Cass, pour lutter contre les guérilleros ; c'était l'Ordre du Jour n° 11 et l'idée de Lane, ce demi-fou du Kansas…
Mais avant la flamme, avant la nuit, il y avait les souvenirs, par milliers, chacun à sa place dans le décor changeant de l'enfance : à cause d'eux, à cause d'un certain arbre ou d'une façon particulière qu'avait eue un jour le vent glissant en dans les herbes, le pays de Sen Benton était en Missouri.
Mais pas Arkansas, pas dans la vallée de Siloam. Ici, ce n'était rien de bon. Ici, l'air avait un goût amer… et six mois après la fin de la guerre, les hommes ne savaient pas vivre autrement que la main sur la crosse et la grimace aux lèvres. Sen était plus mal à l'aise encore quand, parfois, il se disait que l'origine des grimaces et des doigts sur la crosse reposait en partie sur ses épaules à lui.
Épigraphes
Le couard, c'est celui qui, dans une situation périlleuse, pense avec ses jambes (Ambrose Bierce).
Le timide a peur avant le danger, le lâche au milieu du danger, le courageux après le danger (J.-P. Richter).
Revue de presse
Fiche Marabout
1967
Après le drame qui termine La Horde aux abois, Dylan Stark a désormais charge d'âme : il a pris la responsabilité de faire soigner le jeune Caerog, traumatisé par la criminelle folie de son père. C'est accompagné de cette épave incapable de se tirer seule d'affaire que Dylan chevauche vers Siloam. Une fois de plus, Pierre Pelot va camper un décor prodigieux de vérité et de puissance. La petite ville est aux mains de quelques soldats de l'Union, envoyés là pour assurer l'ordre à la fin de la guerre de Sécession. Malheureusement, cette unité isolée de ses chef s'est transformée, comme beaucoup d'autres en ces temps troublés, en une véritable bande de hors-la-loi. Ils font régner la terreur sur Siloam, rançonnant sans vergogne les habitants épouvantés.
Dès son arrivée, Stark emmène Caerog chez le médecin, mais il trouve là le chef des soldats dévoyés, en traitement pour une blessure infligée par un fermier courageux. La tragédie éclate : Stark prend parti pour ceux de Siloam, mais la riposte est sauvage. Il est frappé à mort et le malheureux Caerog est froidement abattu par les bandits en uniforme. C'en est trop : Siloam rejette la peur et se révolte sans attendre d'hypothétiques renforts. L'atmosphère de ce roman, qui ne se terminera que dans le volume suivant de la collection : Les Loups sur la piste, fait invinciblement penser à ces chefs-d'œuvre du cinéma que sont les films de John Ford. Pierre Pelot sent le Far-West et excelle à communiquer au lecteur l'impression de grandeur brutale de ce pays où tout est à bâtir, de cas terres vierges ou l'homme se sent un intrus. Comme toujours, Pierre Pelot met le lecteur dans l'atmosphère : on vit réellement l'action avec ces hommes rudes, aux sentiments contradictoires. On fait le coup de feu avec eux contre les charges répétées des Indiens, on ressent comme eux la terreur et la joie mêlées sans quoi le Far-West ne serait pas cette merveilleuse occasion d'épopées.
|
Page créée le mardi 8 janvier 2002. |